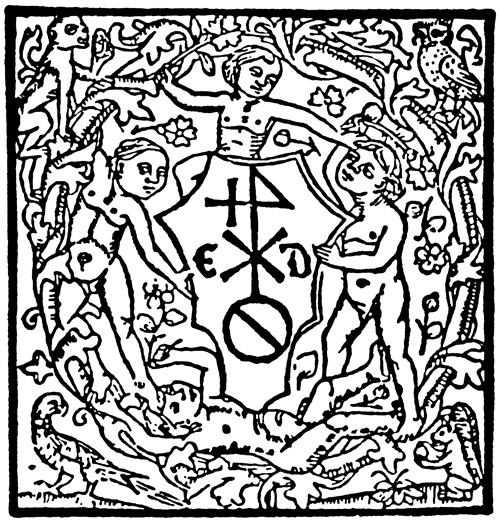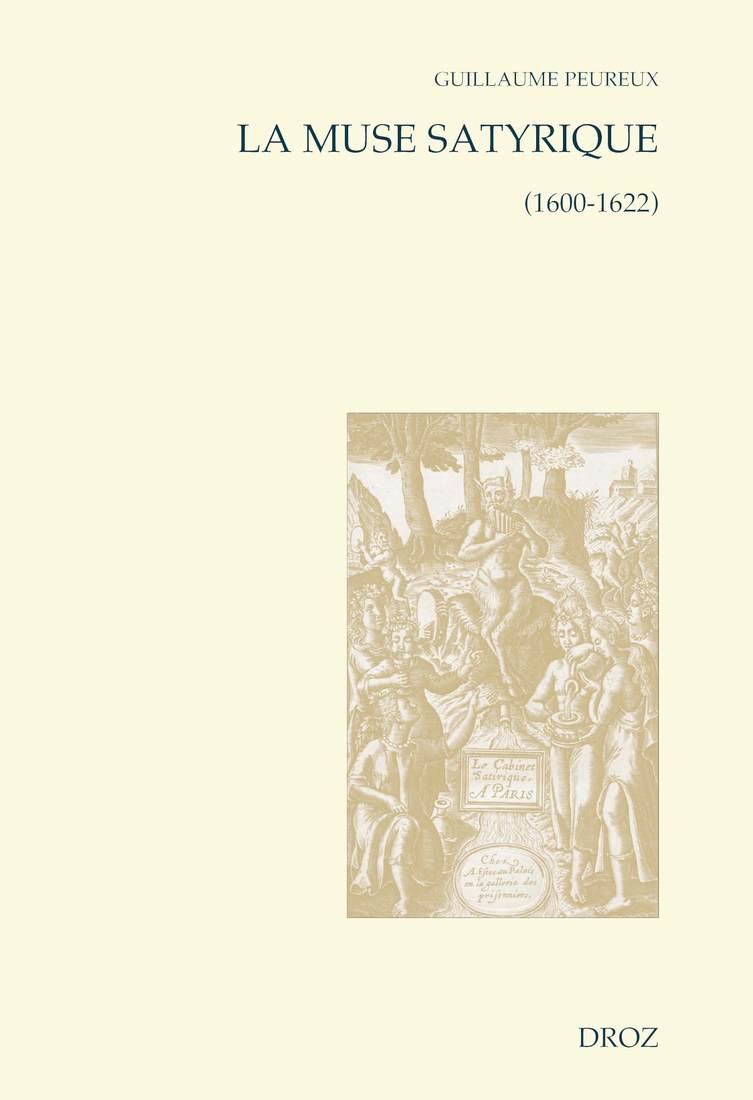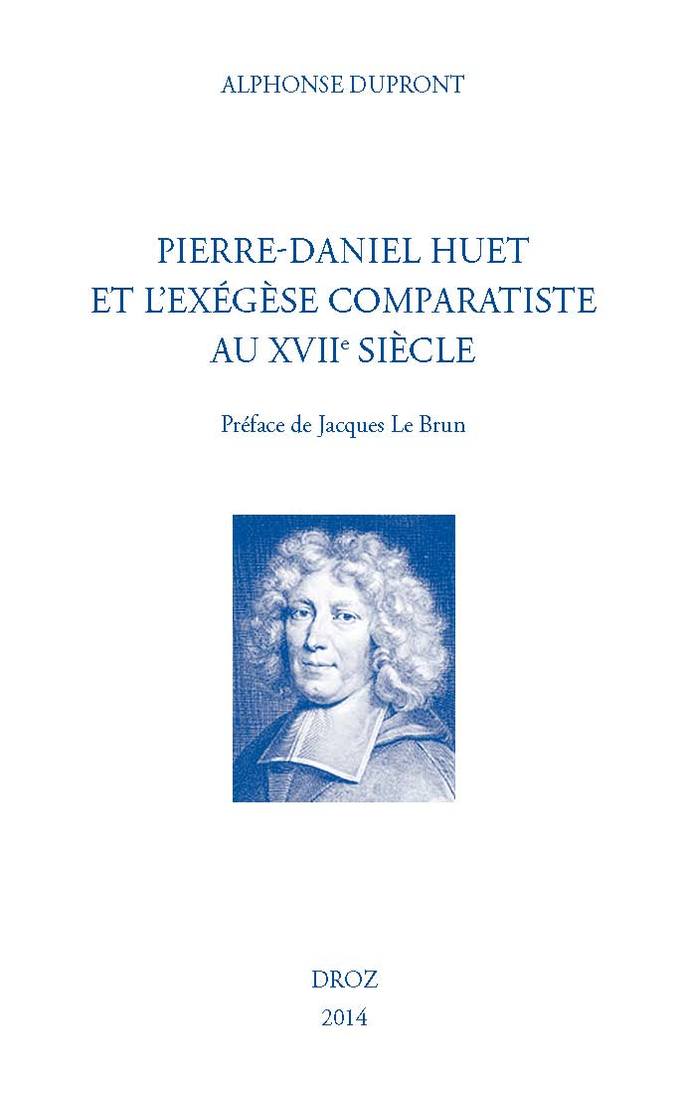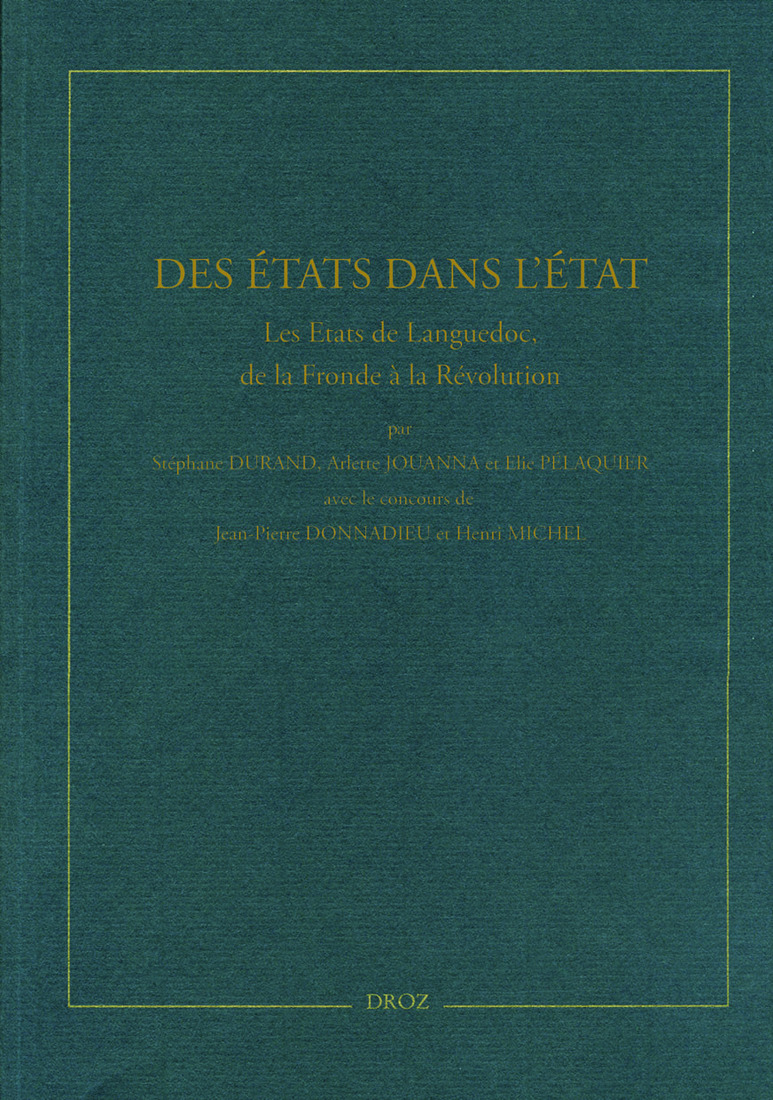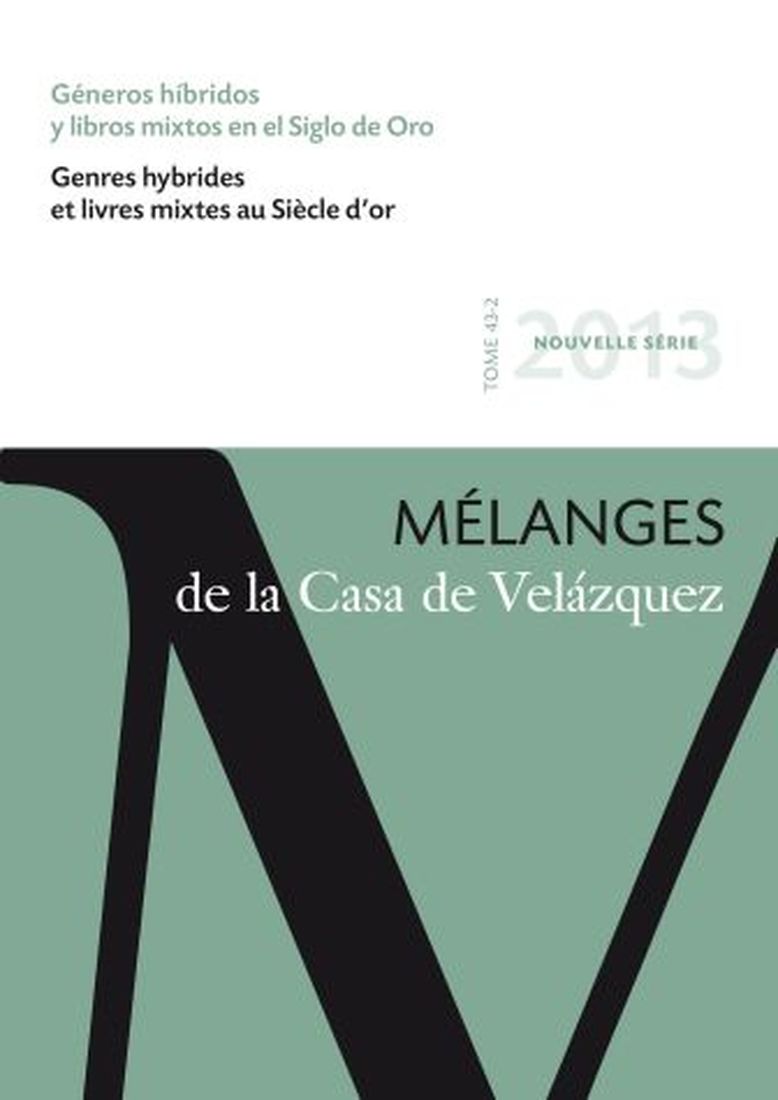XVIIe siècle
Pour la distribution en France : www.sodis.fr
À l’aube des temps modernes, les monarchies espagnole et française se profilent comme les deux plus puissantes d’Europe occidentale. Rivales, elles sont néanmoins liées par d’innombrables liens, politiques et culturels. La volonté de s’affirmer, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leurs états, impose à leurs princes de s’appuyer sur des individus capables de rendre visible, voire présente, leur autorité et leur dignité. Les vice-rois hispaniques, comme les gouverneurs français, ont alors pour mission de représenter l’autorité royale dans des lieux éloignés de la cour, où le roi ne peut être présent. L’affirmation de la majesté, de plus en plus individualisée dans la personne du souverain, semble métamorphoser le rôle de ces lieutenants territoriaux, jadis simples agents, en de véritables images reflétant la personne même du souverain. À l’étranger, cette fonction incombe aux ambassadeurs ainsi revêtus de « la gloire du roi ». Le faste, le cérémonial, les images, la gestualité et la parole, constituent les instruments de cette mission : tenir la place du roi en son absence.
Table des matières
Préface
C. Le Blanc et L. Simonutti
INTRODUCTION
Philosophie, traduction, histoire
C. Le Blanc
Renaissance, Contre-Réforme et Siècle des Lumières : tradition et traduction
M. Vittori
DU TEXTE A LA PENSÉE
Les réflexions humanistes sur la traduction
Humanisme et traduction durant la Contre-Réforme - Girolamo Catena
S.U. Baldassarri
Luther et la germanisation de la Bible
I. Ferron
Ronsard, apologiste de la liberté de traduire
J.-K. Sohn
Les traductions humanistes
Ficin traducteur de Psellus
F. Dell’Omodarme
La Boétie et Montaigne : La Mesnagerie de Xénophon et la « légende socratique »
R. Ragghianti
Montaigne traducteur de Sebond
N. Panichi
Jean Calvin et l’hébreu
M. Engammare
La version hébraique abrégée des Voyages de Jean de Mandeville réalisée par Yohanan Alemanno
F. Lelli
Le De interpretatione de Pierre-Daniel Huet : entre tradition humaniste et critique scripturaire
A. Del Prete
La question de l’auteur/traducteur
Marsile Ficin traducteur de lui-même. Le cas de Christiana Religione
G. Bartolucci
« Politique » dans la terminologie latine de Jean Bodin, auteur des Six livres de la République (1576)
M. Turchetti
« Voces propter res, non res propter voces ». Campanella traducteur de lui-même
G. Ernst
Thomas Hobbes traducteur de lui-même. Les deux versions du Leviathan et les deux procès, du roi et des régicides
M. Turchetti
TRADUIRE LA PHILOSOPHIE
La langue comme outil philosophique
Nāṣir-e Khosrow traducteur des Ikhwān al-Ṣafā’ ?
C. Baffioni
Comenius et le débat sur la langue universelle
A. Cagnolati
Philosophie, magie de la parole, encyclopédie : la Tipocosmia d’Alessandro Citolini
G. Dragnea Horvath
L’art philosophique de la traduction
Les traductions de Machiavel en Angleterre
L. Simonutti
« Aller au fond des pensées ». Giordano Bruno et les traductions
S. Bassi
L’instruction des princes dans l’Europe du XVIIe siècle : la traduction italienne (1677) des écrits pour le prince de La Mothe Le Vayer
L. Bianchi
Sorbière traducteur de Hobbes : l’irruption du politique en traduction
F. A. Cappelletti
Les Platoniciens de Cambridge traducteurs
J.-L. Breteau
Le cas Descartes
Les mots et les pensées. Sur la première traduction latine du Discours de la Méthode
M. Spallanzani
Descartes : traduction, vérité et langue universelle
G. Belgioioso
Descartes et la traduction latine de la morale par provision
L. Delia
La part de Descartes dans la traduction de ses oeuvres : Du Discours de la Méthode a la Dissertatio de Methodo
D. Donna
Spinoza « traducteur » des Principia philosophiae cartesii
C. Santinelli
Traduction et théorie du langage : pratique de la traduction
Verbum sermo ratio. Lectures hétérodoxes du logos de Jean entre les XVIIe et XVIIIe siècles
S. Brogi
Leibniz et la traduction universelle
M. Favaretti Camposampiero
Théorie du langage et philosophie de la traduction chez Christian Wolff
M. Favaretti Camposampiero
Traduction et théorie du langage chez Locke
J.-M. Vienne
Locke traducteur de Nicole : Of the Weaknesse of Man
L. Simonutti
Vico, traducteur de Le Clerc
F. Lomonaco
VERS UNE PHILOSOPHIE DU TRADUIRE : HERMÉNEUTIQUE ET CRITIQUE
Traduction et tradition
Les Epistola pseudo-hippocratiques. Entre traduction, tradition et translation
P. Schiavo
Lucrèce en Angleterre. Echos et traductions du poème lucrétien au XVIIe siècle en Angleterre
D. Pfanner
L’image de l’islam au XVIIIe siècle entre érudition et vulgarisation. Notes sur la traduction française du De religione mahommedica d’Adriaan Reeland
R. Minuti
Antiquité, modernité, traduction
Terrible merveille
E. Barilier
Une Antiquité controversée et diversement adaptée : l’Ars poetica d’Horace dans les commentaires et la poétique des XVIe et XVIIe siècles
S. Richter
Vers la modernité
La question de l’équivalence dans la traduction
F. Ervas
Vingt ans après : Alexander von Humboldt se réécrit et se traduit lui-même
S. Poggi
Wilhelm von Humboldt et le paradigme de la traduction
I. Ferron
INDEX des noms
S'interroger sur le point de vue du traducteur, dans la mesure où le sens produit en dépend, représente une démarche essentielle de l'étude de la pratique de la traduction. En effet, Nietzsche n'a pas lu Epicure comme Gassendi, Avicenne n'entendait pas Aristote comme Heidegger. La place du lecteur dans un espace-temps donné est fondamentale pour l'interprétation du sens d'un énoncé. L'Histoire apparaît ainsi comme ce qui définit une communauté ou une séparation d'univers et de discours, entre l'auteur et son lecteur.
Traduction et Histoire vont de pair au niveau théorique, et s'il est une chose qu'enseigne l'étude de l'histoire des traductions, c'est que la pluralité des lectures l'emporte toujours sur l'unité sémantique d'un texte. La nécessité de retraduire encore et encore certaines œuvres met clairement en évidence ce phénomène.
Si l'une des questions théoriques essentielles de la traduction est de s'interroger sur le sens des énoncés, question pressante en philosophie, il faut, pour comprendre ce qu'est traduire, inscrire la réflexion dans l'Histoire, mettre à jour et rendre intelligible le lien originel entre la question du sens des énoncés et celle de ses variations dans le temps. Cet ouvrage, contenant une quarantaine de contributions traitant de projets de traduction des XVIe-XIXe siècles, à partir du grec, du latin, de l'hébreu, de l'arabe, du français ou de l'italien, s'y engage.
Dans une large mesure, le travail des traducteurs, tant d'un point de vue philosophique qu'historique, a contribué à former la personnalité de l'Occident. Par rapport au texte original, la traduction parfois adoucit les traits, parfois les charge, parfois exagère une expression ou en atténue une autre, semblable en cela aux travestissements des fêtes ; car la lecture est une fête : elle l'a été de la Renaissance aux Lumières, et la traduction, elle, fut à maints égards le visage même de plusieurs auteurs. En une formule, elle fut souvent le masque de l'écriture.
Une série de recueils collectifs de poésie satyrique (satire inspirée de la figure du satyre grec), brutale à l’égard des victimes qu’elle se donnait, grivoise, obscène, érotique ou pornographique, parut en France entre 1600 et 1622 : cinquante-trois volumes (rapidement édités, de manière souvent négligée), environ mille six cents poèmes et cent cinquante poètes identifiables envahirent en peu de temps le m0arché de la librairie.
A partir de la notion d’effets de recueils, c’est-à-dire en réfléchissant aux poèmes à partir de leur insertion dans des séries (de thèmes et motifs, de textes, de recueils) et des différents effets produits par la masse imprimée, Guillaume Peureux analyse dans cet ouvrage la manière dont la satyre produit sa propre légitimité dans le champ poétique. L'auteur examine aussi les discours ou représentations qu’elle véhicule afin de se donner les moyens de proposer des pistes d’interprétation pour cet événement littéraire révélateur d’une crise de la poésie et, peut-être, de la masculinité au seuil de la modernité.
Alphonse Dupront (1905-1990), normalien, agrégé d’histoire, premier président de l’Université de Paris IV-Sorbonne (1970), est surtout connu pour sa thèse sur le Mythe de croisade et pour ses recherches d’anthropologie religieuse. Son Pierre-Daniel Huet et l’exégèse comparatiste au XVIIe siècle est certes une œuvre de jeunesse, mais, comme le souligne Jacques Le Brun dans une longue et passionnante préface à la réédition, elle est forte d’une intuition d’ordre théorique et d’une attitude subjective, neuves l’une et l’autre. Dupront remet en effet au centre de l’œuvre de Huet, qui n’était plus guère connu dans les années 1920 que comme l’auteur du Traité de l’origine des romans, la Demonstratio evangelica de 1679. Ce faisant, Dupront montre que le Grand Siècle fut un temps d’inquiétude, “un siècle tourmenté entre tous” ; Huet était lui-même un inquiet religieux, cette inquiétude née peut-être de son exégèse comparatiste, puisqu’il compara les cultures, les civilisations, les croyances, les religions des antiques païens et des peuples de la Bible, juifs et chrétiens, et de sa comparaison il établit des dépendances, des filiations, des mutations. Le premier livre d’un grand penseur est toujours riche d’intuitions et de promesses fécondes. Il n’en est pas autrement avec Pierre-Daniel Huet et l’exégèse comparatiste au XVIIe siècle.
La tragédie, c’est bien connu, finit mal. Au point que le terme « tragique » définit désormais tout événement funeste et sanglant. Mais la fin malheureuse n’a pas toujours été un élément essentiel du genre. C’est seulement lors de sa renaissance moderne que le dénouement malheureux a acquis une telle importance et ceci, en dépit de son manque de bienséance morale: si la tragédie finit mal, c’est que le héros, contre toute attente, n’est pas récompensé pour ses vertus et que les actions du méchant ne reçoivent pas la punition escomptée. Le dénouement malheureux est efficace, car il suscite la surprise et le pathos. Mais il contrevient aux conventions éthiques qui règlent la poétique renaissante: il n’est pas exemplaire. Par l’étude de la tragédie européenne de la première modernité, et plus spécifiquement de la théorie et de la pratique du genre en Italie, en France et en Espagne, cet ouvrage entend expliquer pourquoi le dénouement malheureux devient l’élément essentiel du genre au moment même où toute forme de poésie se doit d’être exemplaire. La tragédie moderne exprimerait alors la contradiction entre ce qui devrait être et ce qui est, en relevant l’écart qui sépare la foi en la providence divine et l’évidence de l’échec, de l’injustice et du malheur.
Les États de Languedoc, assemblée délibérative composée des représentants du clergé, de la noblesse et du tiers état, ont géré la province de Languedoc depuis le XVe siècle jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Leurs séances étaient annuelles ; le vote était organisé par tête et non par ordre, originalité d’autant plus grande que le tiers disposait à lui seul du même nombre de voix que les deux premiers ordres réunis.
À partir du milieu du XVIIe siècle s’est affirmé leur rôle politique et économique. Outre la prérogative du consentement de l’impôt, pas toujours fictive, ils ont assumé des responsabilités croissantes dans le développement des voies de communication et la mise en valeur du territoire provincial. Leurs relations avec le pouvoir royal reposaient sur la négociation, le plus souvent déférente mais parfois traversée de tensions. Loin d’être des survivances archaïques d’un passé révolu, ils révèlent, par leur activité, un aspect méconnu de la monarchie, beaucoup moins centralisatrice et absolutiste qu’on ne le croit.
Jonathan Carson propose l’édition de l’œuvre complète de Scarron, neuf pièces en cinq actes composées entre 1645 et 1662, ainsi que les Fragmens de diverses comedies et deux extraits des Boutades du Capitan Matamore. Présentée de manière diachronique, l’édition met en perspective le développement de la technique dramaturgique de Scarron, qui n’est pas qu’un auteur burlesque, contrairement à ce qui est communément admis. L’introduction présente les différentes thématiques propres à son théâtre, mettant en lumière le traitement d’importants sujets sociétaux. Toutes les pièces, hormis le Prince corsaire, trouvant leur source dans le théâtre espagnol contemporain, Jonathan Carson propose une analyse des modes de réécriture et de transposition utilisées par l’écrivain, et fait précéder chaque oeuvre d’une description de sa matière première, à l’exception du Marquis ridicule, dont la source espagnole n’a jamais été imprimée. Enfin, cette édition retrace l’histoire complète du théâtre imprimé du vivant de l’auteur.